

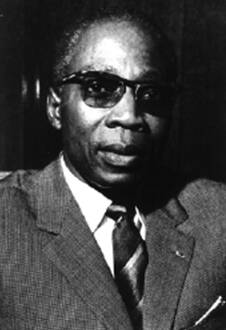
Mon père a
rencontré de nombreuses personnalités tout au
long de sa vie, je n'en fais pas ici la liste exhaustive,
mais, il a mentionné
ceux qui suivent de nombreuses fois :
Il rencontrait souvent l’ancien président du Sénégal Léopold Sédar Senghor et Aimé Cesaire (écrivain des Négritudes)
lors de ses sorties au camp du Trait d’union dans la vallée de Chevreuse dans les années 1930:


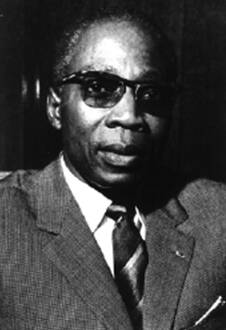
Au
contact des
jeunes
africains étudiant à Paris, Aimé
Césaire et
son ami guyanais Léon Gontran Damas, qu’il
connaît
depuis la
Martinique, découvrent progressivement une part
refoulée
de leur identité, la
composante africaine, victime de l'aliénation culturelle
caractérisant les
sociétés coloniales de Martinique et de Guyane.
En septembre
1934, Césaire fonde,
avec d’autres étudiants antillo-guyanais et
africains (parmi lesquels Léon
Gontran Damas, le Guadeloupéen Guy Tirolien,
les Sénégalais Léopold
Sédar Senghor et Birago Diop),
le journal L'étudiant noir.
C’est dans les pages de cette
revue qu’apparaîtra pour la première
fois le terme de « Négritude ».
Ce concept, forgé par Aimé Césaire en
réaction à l’oppression culturelle du
système colonial français, vise à
rejeter d’une part le projet français
d’assimilation culturelle et à promouvoir
l’Afrique et sa culture, dévalorisées
par le racisme issu de l'idéologie colonialiste.
Construit
contre
l'idéologie coloniale française de
l'époque, le projet de la Négritude est plus
culturel que politique. Il s’agit, au delà
d’une vision partisane et raciale du
monde, d’un humanisme actif et concret, à
destination de tous les opprimés de
la planète. Césaire déclare en
effet : « Je suis de la race de ceux
qu’on opprime ».
Ayant
réussi en 1935 le
concours d'entrée à l'École normale
supérieure, Césaire passe
l'été en Dalmatie
chez son ami Petar Guberina et commence à y
écrire le Cahier d'un retour
au pays natal,
qu'il achèvera en 1938. Il lit en 1936 la traduction de
l’Histoire de la civilisation
africaine de Frobenius. Il prépare sa sortie en
1938 de l'Ecole normale
supérieure avec un mémoire,
« Le Thème du Sud dans la
littérature
négro-américaine des USA ».
Épousant en 1937 une étudiante
martiniquaise, Suzanne Roussi, Aimé Césaire,
agrégé de lettres, rentre en Martinique en 1939,
pour enseigner,
tout comme son épouse, au lycée
Schœlcher.
En 1937, il prend position contre le mouvement fasciste de Franco en Espagne
Avec Guernica, en 1937,
Picasso réalise sans aucun doute
l’œuvre la plus célèbre du
20ème siècle. Cette oeuvre est aussi le premier
signe tangible de l'engagement politique de Picasso. En
représentant l'horreur
de la guerre civile, il prend parti contre l'Espagne de Franco et les
régimes
totalitaires.
Pablo Picasso réalisa ce tableau à la demande du
gouvernement républicain
espagnol pour le pavillon de l'Espagne à l'Exposition
Internationale de Paris
de 1937. Conservé ensuite au Musée d'Art Moderne
de New-York, le tableau ne
gagnera Madrid qu'en 1981, une fois la démocratie
rétablie en Espagne. Ainsi
l'avait souhaité Picasso. L'oeuvre est actuellement
exposée au Centro de Arte
Reina Sofia, tout près du Musée du Prado
à Madrid.
Le gouvernement espagnol, pour son pavillon de l'Exposition internationale, qui devait se tenir à Paris en 1937, commanda à Picasso une grande composition murale. Il s'inspira d'un épisode de la guerre d'Espagne, le bombardement de la ville basque de Guernica par les avions allemands, le 28 avril 1937. Achevé en moins de deux mois, Guernica ne représente pas directement l'événement!; Picasso y symbolise plutôt l'horreur des conflits humains par l'emploi de formes exprimant l'éternelle cruauté : le taureau, le cheval agonisant, le guerrier tombant, la mère et son enfant mort, la femme emprisonnée dans un immeuble en flammes

Dès 1933, il milite contre le fascisme et le nazisme, puis rejoint les républicains espagnols à partir de 1936. Il monte de toutes pièces l'escadrille España avec une vingtaine de Potez et en prend le commandement comme coronel (colonel), jusqu'en 1937. Après s'être inspiré de son combat pour écrire le roman L'Espoir, publié en décembre 1937, il tourne le film Espoir, sierra de Teruel en 1938, puis s'engage en 1939, à la déclaration de guerre.
1936 En Espagne, un général nommé Franco déclenche la guerre civile. Partout en Europe, des brigades internationales se créent pour secourir les républicains espagnols. André Malraux prend le commandement de l'escadrille "España" et participe aux combats à Medellin, Madrid, Tolède, Teruel..
Le temps du
mépris (Gallimard)
Préface de Indochine SOS
d'Andrée Viollis(Gallimard)
1937 Voyage aux Etats-Unis pour
défendre la cause des républicains
espagnols.
"L'Espoir" (Gallimard)
1938 Tournage du film "L'Espoir"
1939 La guerre d'Espagne se conclut sur la victoire de Franco, la deuxième guerre mondiale commence. A 38 ans, Malraux s'engage dans l'armée française. Fait prisonnier en 1940, il s'évade et gagne la zone libre.
Évadé d'un camp de prisonniers, avec l'aide de
son
demi-frère Roland, il adopte une attitude attentiste avant
d'entrer tardivement en résistance,
en mars 1944, après l'arrestation en Dordogne de ses deux
frères. Il dit alors être le chef de la
région
militaireFFI de la région qui s'étend du Limousin
au
Lot-et-Garonne, un rôle joué indiscutablement
à
cette époque par un autre. Il organise bien des
réunions
avec quelques chefs locaux, mais ceux-ci ne le reconnaissent jamais
comme leur chef. Le colonel Berger,
comme il se fait appeler, apparaît ainsi
extrêmement seul
lorsqu'il est arrêté par les Allemands
àGramat,
avec un officier anglais du SOE (Special Operations Executive). Il est
transféré de prison en prison jusqu'à
Toulouse
pour des interrogatoires au terme desquels il est l'objet d'un
simulacre d'exécution. Il se retrouve libre quand les
Allemands
quittent la ville. Il commande ensuite la brigade «
Alsace-Lorraine » pendant la libération du sol
français .
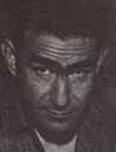
Né en 1913 et mort en 1960, Atlan produisit des œuvres d’inspiration abstraite dans un style très particulier. Il ne se fit cependant vraiment connaître que durant les années 1950 lorsque Gertrude Stein lui acheta des toiles. Lancé au sein de la Nouvelle Ecole de Paris, il exposa notamment ses oeuvres à Tokyo en 1956 après les avoir montrées avec succès à Paris.
Très poétique, Atlan représenta des signes d’inspiration orientale et mystique sur ses toiles en cherchant moduler l’espace pictural à travers des formes et des couleurs.
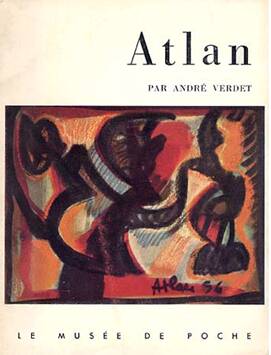
Ses œuvres furent avant tout très rythmées avec une connotation très africaine où les formes étaient chargées
d’un fort pouvoir émotionnel et soulignées de traits noirs prononcés.
Peintre des pulsions, Atlan fit preuve d’une rare propension à conjuguer la poésie du subconscient.



Il à rencontré Paco Ibañez à Barcelone en Aout 2000, à l’occasion du mariage de ma petite cousine Olivia. Il était un fervent admirateur de ce chanteur anti-franquiste épris de révolution, de liberté et de poésie.
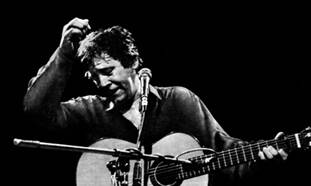
Paco
Ibáñez est né à Valencia en
1934. Il est le plus jeune
de quatre frères et sœur. Son père
valencien et sa mère basque ont d'abord
habité Paris avant de rejoindre l'Espagne en 1933 et de se
voir contraints de
prendre le chemin de l'exil après la guerre d'Espagne.
Tandis que son père était enfermé dans
un camp de travail français, la famille
trouva refuge dans la ferme Apakintza près de Saint
Sébastien. Son disque
"Oroitzen" (Souvenirs) retrace les souvenirs de cette
époque.
Le gouvernement espagnol inclut Paco Ibáñez dans
la longue
liste des censurés. La difficulté de continuer
à vivre à Barcelone le pousse à
retourner à Paris, d'où il voyage dans monde
entier en apportant partout la
poésie espagnole d'aujourd'hui et de toujours.
En 1990, il s'installe en Espagne, d'abord à Madrid, ensuite au Pays Basque. Depuis 1994, il réside à Barcelone.
Retour page d'accueil Retour haut de la page